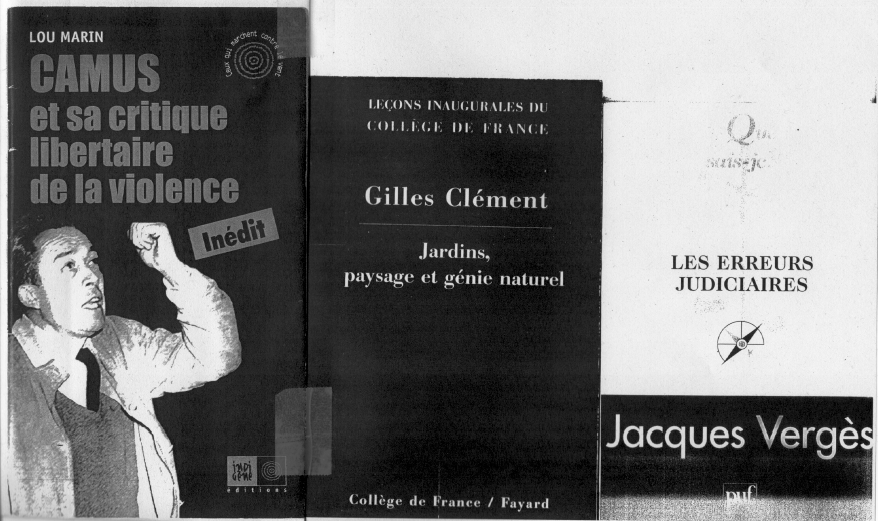Trois petits livres, petits par leur taille mais denses par leur contenu, viennent illustrer ce billet, qui, même s’ils abordent des thèmes différents, ont des points communs, cela est sans doute dû à la qualité humaine de leurs auteurs, et on finit par leur trouver un fil conducteur.
L’auteur du premier[1] est Gilles Clément, ingénieur horticole, jardinier comme il se nomme lui-même et enseignant, articule ses travaux autour des concepts de « jardin en mouvement », de « jardin planétaire » et de « tiers-paysage ». L’ouvrage, intitulé « Jardins, paysage et génie naturel », est la leçon inaugurale que Gilles Clément prononça le 1er décembre 2011 au Collège de France. D’entrée il a l’humilité de dire « de mon point de vue, le jardin ne s ‘enseigne pas, il est l’enseignant » et de placer les acteurs à leur place en ne se donnant pas le premier rôle.
Il fait une distinction entre le « paysagiste », celui qui règle l’esthétique changeante du jardin, et le « jardinier », celui qui interprète au quotidien les « inventions de la vie », une sorte de magicien. Gilles Clément se range clairement dans cette dernière catégorie.
Avant de poursuivre, il veut donner sa propre définition sur des termes que le langage courant fait trop souvent se ressembler :
-« le paysage », c’est ce qui est sous l’étendue du regard, donc du domaine du subjectif.
-« l’environnement », c’est l’analyse scientifique de ce qui nous entoure, donc du domaine de l’objectif.
-« le jardin », c’est à la fois l’enclos et le paradis, on y va « l’esprit nu et le corps exposé ». C’est une fabrique de paysage, se prêtant aux jeux de l’environnement et contenant le rêve, c’est-à-dire un projet de société.
Jadis espace enclos, comme le « jardin de curé », le jardin a changé d’échelle au cours du XXème siècle pour devenir planétaire avec la conscience écologique. D’architecte traçant les cheminements et distribuant les essences dans un espace donné, le jardinier devient responsable du vivant, chargé de protéger la vie dans sa diversité. Il doit « faire le plus possible avec les énergies en place, et faire le moins possible contre les énergies en place » en un lieu déterminé. Alors que l’architecture va connaître à partir du milieu du XIXème siècle des transformations radicales sous la poussée de l’industrialisation et des moyens de locomotion, c’est un siècle plus tard que le jardin, et l’agriculture en général, va changer de méthodes et d’échelle, pressé par les industries phytosanitaires et agroalimentaires. Comme l’architecture, le jardin, pour maintenir un équilibre vital, doit tenir compte d’un développement durable, en respect avec toutes les espèces vivantes et le milieu qui l’accueille.
La fonction « temps » différencie l’architecte du paysagiste-jardinier ; alors que le premier, à la fin de sa mission, livre une construction « finie », le second livre un jardin en devenir qui n’en est qu’au « commencement » et la nature est cosignataire de son œuvre. Cette notion de « prendre le temps », si importante pour le jardin, est la conclusion au discours de Gilles Clément : « alors j’invite les oisifs, les prétendus inutiles, les lents, les accidentés de la vitesse à venir construire le projet de demain. Nous avons besoin de leur résistance à l’immédiate réponse, de leur capacité à s’étonner, à prendre le temps et à le laisser suivre son cours ».
Gilles Clément nous donne à voir deux faces du jardinier aujourd’hui, celui cultivant son carré de terrain pour sa survie, et celui travaillant à l’échelle planétaire pour la survie des êtres vivants en général et de l’humanité en particulier.
Ce discours commence comme une paisible « leçon de choses », une promenade dans un jardin de curé, il finit par une leçon écologique, magistrale et planétaire. Une façon de toucher du doigt l’universel, de nous donner du goût et de l’espoir.
Le second livre[2], polémique, est à l’image de son auteur, l’avocat Jacques Vergès. Dès la préface, le ton est donné par quelques précisions et définitions :
-« erreur judiciaire », le terme n’existe pas dans le Code de procédure pénale, heureusement le dictionnaire nous précise que c’est une condamnation pénale prononcée à tort,
-« fréquence des erreurs judiciaires », quand Montaigne affirme que la condamnation d’un innocent est « plus crimineuse que le crime »,
-« responsabilité niée dans les erreurs », alors que, Montaigne encore, dit qu’il faut avoir « cette inquiétude d’esprit qui fait qu’après avoir trouvé le vrai, on le cherche encore »,
-« procédure inquisitoire », ce système judiciaire français qui donne aux juges un pouvoir sans contrôle autre que celui de leurs pairs.
Jacques Verges construit son pamphlet comme une plaidoirie de « défense de rupture » : classant quelques erreurs judiciaires célèbres par thèmes, démontrant les failles d’une justice plus aveugle qu’impartiale sous le bandeau qui la symbolise, il plaide pour une véritable réforme de la justice.
Les cinq premières, les affaires Calas, Dreyfus, La Roncière, Rida Daalouche et Rosalie Doise, montrent des erreurs judiciaires inspirées par des préjugements, que Vergès nomme « faute originelle», qu’elle soit d’essence religieuse, raciale, sociale, ou tout simplement due à la faiblesse mentale d’un juge.
Les cinq suivantes, les affaires Mis et Thiénot, Deshays, Deveaux, Dils et Dominici, montrent la fragilité des convictions forgées sur ce que Vergès appelle la « religion des aveux », parfois extorqués par la violence ou l’intimidation, incohérents ou peu fiables car venant d’êtres fragiles ou immatures. Pour Vergès, « l’aveu, longtemps considéré comme la reine des preuves, est la solution de paresse par excellence ».
Les cinq autres, les affaires Solera, Mauvillain, Ranucci, Violette Nozières et celle du courrier de Lyon, résument ce que Vergès appelle « le bon usage des témoignages », leur utilisation, ou non, aux fins d’orienter la preuve de culpabilité, selon qu’ils soient préférés, ignorés, disqualifiés.
Les cinq dernières, les affaires Marie Besnard, Marguerite Marty, Dupriez, Action directe, enfin celles de Dreyfus et Omar Raddad réunies, forment une critique sur « l’utilisation des experts ». La science, sous couvert d’objectivité, peut parfois être source d’erreur et orienter les convictions. Certaines disciplines, en graphologie, en psychiatrie, laissent planer des incertitudes ou des vides que des juges cherchent à combler.
La justice, quand elle n’a pas elle-même fabriqué l’erreur, tarde souvent à la reconnaître par esprit de corps, et par crainte de déstabiliser une institution qui doit montrer son inflexibilité et son impartialité coûte que coûte. « Les erreurs judiciaires découlent de cette intuition des enquêteurs (qui leur font subir comme vrai ce qui n’est pas encore démontré), de leur paresse et de leur orgueil qui leur font négliger ensuite de confronter la prétendue intuition aux faits » écrit Vergès. Par la suite les juges s’engouffrent dans cette brêche et une machine infernale se met en branle : la récente affaire Outreau a mis en évidence les dysfonctionnements de l’institution judiciaire et de sa frilosité à se remettre en cause. Les propositions de la commission d’enquête parlementaire pour d’éventuelles réformes ont eu un faible impact législatif.
Le troisième livre[3] de Lou Marin est bien dans la suite des deux premiers, la protection de la vie dans sa diversité et la soif de justice. Avec ce « Camus et sa critique libertaire de la violence », c’est le « génie libertaire » qui est ici mis au service du philosophe pour conjurer la violence et l’anéantir, afin de faire triompher la révolution par des méthodes pacifistes comme le fit Gandhi en Inde. C’est ce Camus, trop hâtivement classé défenseur de la démocratie occidentale à des fins de récupération politique quand il dénonçait dès 1930, bien avant tous les intellectuels de tous bords, la Russie communiste liberticide, c’est le portrait de ce Camus anarchiste , libertaire et non violent que Lou Marin nous dépeint, citant de façon éloquente le philosophe de « L’Homme révolté » : « La société de l’argent et de l’exploitation n’a jamais été chargée, que je sache, de faire régner la liberté et la justice », et plus loin : « Les opprimés ne veulent pas seulement être libérés de leur faim, ils veulent aussi l’être de leurs maîtres »[4].
La pensée d’Albert Camus rejoint l’action de Jean Prouvé et de son attitude envers les ouvriers de son usine de Maxéville quand il dit : « La société industrielle n’ouvrira les chemins d’une civilisation qu’en redonnant au travailleur la dignité du créateur, c’est-à-dire en appliquant son intérêt et sa réflexion autant au travail lui-même qu’à son produit (…) chaque fois que, dans un homme, elle tue l’artiste qu’il aurait pu être, la révolution s’exténue un peu plus »[5]. Combien de vieux architectes sommes-nous, frustrés de notre créativité et du feu révolutionnaire de nos jeunes années ?
En une vingtaine de pages, Marin nous déroule le parcours de Camus et sa mutation vers une non violence révolutionnaire. La revendication à l’objection de conscience jusqu’au début de la seconde Guerre mondiale alors qu’il est à Alger, va se muer en désobéissance civile sur le sol français, devenu journaliste à Combat qui soutient la résistance armée. Il se démarque alors de certaines pratiques des résistants, l’exécution des prisonniers allemands, la stratégie consistant à faire monter le sentiment de haine contre l’occupant nazi avec des attentas voués à des représailles. Il dénoncera cette pratique en 1949 dans sa pièce « Les Justes », mettant en scène un groupe révolutionnaire, tenaillé entre l’idéal révolutionnaire et un sentiment humaniste.
Sur le marbre du journal Combat Camus noue des liens forts avec les travailleurs du Livre et ouvriers typographes et imprimeurs. Un Camus anarcho-libertaire se forge, s’opposant aux deux blocs Est et Ouest qui s’affrontent après s’être ligués pour écraser le nazisme. Il veut surtout mettre des limites, sinon fin, aux violences de toutes sortes, d’où qu’elles viennent et quelles qu’en soient les raisons, violences d’état (métaphysique) comme violence révolutionnaire (historique), la seule trouvant grâce aux yeux de hiboux comme Sartre.
Après la guerre, et bientôt confronté aux violences se déroulant sur sa terre natale d’Algérie, celles du massacre de Sétif dès 1945, comme l’insurrection de 1954 et des années qui s’ensuivirent jusqu’à la déclaration d’indépendance en 1962, Camus écrit en 1949 dans la revue « Défense de l’homme » du pacifiste Louis Lecoin : « Je crois que la violence est inévitable (…) je dis seulement qu’il faut repenser toute légitimité de la violence. Elle est à la fois nécessaire et injustifiable. Alors je crois qu’il faut lui garder son caractère exceptionnel, précisément, et la redresser dans les limites qu’on peut. Cela revient à dire qu’on ne doit pas lui donner de significations légales ou philosophiques ». Esquissant les formes que peuvent prendre la non violence dans « L’<Homme révolté », Camus prêche une non violence qui soit un moyen de lutte restant fidèle à ses fins : « la fin justifie les moyens ? Cela est possible . Mais qui justifiera la fin ? A cette question, que la pensée historique laisse pendante, la révolution répond : les moyens ».
La violence dans les deux camps du conflit algérien est une souffrance pour Camus, et le fait définitivement basculer dans l’espérance d’une révolution pacifique, à la façon de celle menée dix ans plus tôt en Inde par Gandhi, que Camus considère comme « le plus grand homme de notre histoire»[6].
Peut-être sa participation à la Résistance lui donnera des scrupules à se reconnaître non violent ? A la Libération, et contrairement à Sartre, qui se montrait intransigeant bien qu’ayant eu avec de Beauvoir un rôle trouble durant la guerre, Camus s’opposera à la peine de mort prononcée contre Robert Brasillach en 1945, et s’insurgera contre les exactions commises sur les collaborateurs.
Pour Camus, « non violence » n’est pas synonyme de passivité et d’immobilisme. Au contraire, elle est à l’initiative d’actions originales, inédites, autant sinon plus inventives que celles qui ont motivé la violence de l’homme dans l’histoire, avec cette recherche et cette invention de procédés toujours plus dévastateurs et cruels, pour torturer, tuer et dominer. Sans doute le Camus « algérien » aurait aimé voir les nationalistes adopter cette politique de résistance passive plutôt que d’appliquer la terreur et la surenchère dans l’horreur afin d’impliquer l’ensemble de la population algérienne, et faire basculer le conflit à l’avantage de l’ethnie la plus nombreuse. Il faut dire que c’est un terrain que la colonisation avait bien préparé.
De 1930 jusqu’à sa mort sur une route de l’Yonne, la critique que fait Camus de la violence reposa à la fois sur celle exercée par le pouvoir bourgeois et capitaliste, comme sur celle exercée par les révolutions quand elles ne respectent plus les valeurs qu’elles incarnent. Camus, par sa critique libertaire de la non violence, en espère l’envers : une révolution non violente en faveur de la vie.
Vincent du Chazaud, le 09 août 2012
[1] Gilles CLEMENT, « Jardins, paysage et génie naturel », librairie Arthème Fayard et Collège de France, Paris, 2012
[2] Jacques VERGES, « Les erreurs judiciaires », PUF, Paris, 2002
[3] Lou MARIN, « Camus et sa critique libertaire de la violence », Indigène éditions, Montpellier, 2011
[4] « Restaurer la valeur de la liberté », discours prononcé devant les syndicats à Saint Etienne le 10 mai 1953
[5] Albert Camus, « L’Homme révolté », Gallimard, collection Folio, Paris, 1985
[6] Albert Camus, « La chaussette et le rouet », in Cahiers Albert Camus 6, , Gallimard, Paris, 1987